| Notre montage # 315 est disponible pour écoute et téléchargement depuis la chaîne Community Audio du site Internet Archive à l'adresse suivante: https://archive.org/details/pcast315
|
=====================================================================
Lors de
notre plus récent B+B, j’ai fait référence avec un brin de nostalgie à la
programmation de Télé-Métropole pendant les quinze premières années de son
existence (alors que le Réseau TVA n’offrait essentiellement qu’un bulletin de
nouvelles les soirs de semaine à 22 heures 30…). La plage horaire entre le
« cinéma de soirée » et ce bulletin de nouvelles était souvent
remplie par de la programmation de fortune : « Tout le Monde en
Parle », l’ancêtre québécois de TMZ, les Découvertes du Dix, l’ancêtre des
concours-tremplin comme La Voix et Star Académie, et « Deux Pianos »,
auquel j’ai déjà fait une référence diagonale.
De 1962 à
1975, Yoland Guérard a animé un bon nombre de ces émissions; aux « Découvertes
» mentuionn.es précédemment, on ajoute « L'Âme des poètes », « L'Univers de
Yoland Guérard » et « Québec sait chanter ».
M. Guérard
savait chanter lui aussi! Initialement formé au basson au conservatoire, et
après s'être classé deuxième comme chanteur au concours « Les Boursiers de CKAC
», il se dirigea vers une carrière vocale - avec une voix basse pure - et
étudia avec Albert Cornellier. Après des engagements à la radio, il débuta aux Variétés
lyriques en 1948. En 1950, il participa à la tournée en Europe des
Disciples de Massenet et, grâce à une bourse du gouvernement du Québec, il
étudia à Paris avec Robert Salvat, Ninon Vallin et Vanni-Marcoux. Il chanta le
rôle de Méphisto (Faust) à l'Opéra de Lyon en 1951 et son succès lui
valut un engagement dans l'opérette Chanson gitane de Maurice Yvain.
Son retour
à Montréal en 1952 coïncida avec les débuts de la télévision canadienne : il
fut la vedette de nombreuses émissions lyriques, en plus de chanter. En 1954,
il fit aux États-Unis une tournée de deux ans, succédant à Ezio Pinza dans le
rôle d'Émile de Becque (South Pacific). Il fut vice-président fondateur
du Grand Opéra de Montréal avec lequel il chanta le rôle titre de Don
Giovanni en 1957 et Don Basilio dans Le Barbier de Séville en 1958.
À la t.k. et sur scène, il chantera et mettra en scène de nombreuses
productions d’ ‘ioopérettes et opéras plus ou mons légers. Parallèlement,
il chanta à l'Opéra de Marseille dans Viva Napoli (1973) et au théâtre
Sébastopol de Lille dans Gipsy de Lopez (1974). En 1985, il fut nommé
directeur du Centre culturel canadien à Paris, poste qu'il occupa jusqu'à son
décès, le 2 novembre 1987.
J’ai de
beaux souvenirs de Guérard accueillant les grandes voix québécoises de l’époque
à son émission Québec sait chanter – que ce soit une jeune Colette Boky,
ou des chanteurs établis comme Robert Savoie et André Turp. En dépit de la
quantité faramineuse de clips sur YouTube, aucun clip de cette émission
– unr invitation donc à ceux qui en auraient!
Afin de
souligner la Fête Nationale du Québec (lundi dernier, le 24 juin) j’ai choisi
d’assembler un montage mettant en vedette des voix québécoises d’aujourd’hui
ainsi que des voix du passé qui sans nul doute furent des invités de marque
chez M. Guérard!
(NDLR –
les notes biographiques qui suivent sont essentiellement extraites de sites
promotionnels et autres ressources du web.)
Les Voix
d’aujourd’hui
Reconnue
tant pour la riche beauté de sa voix que pour sa présence scénique
charismatique, la soprano Marianne Fiset est l'une des artistes lyriques
canadiennes les plus en demande. On retiendra ses débuts à l’Opéra National de
Paris dans le rôle titre de Manon de Massenet, Mimi dans La Bohème
à Tampa, Vancouver et Sankt Margarethen Opernfestspiele, Donna Elvira dans Don
Giovanni à l’Opéra municipal de Marseille, Susanna dans le Nozze di
Figaro pour le Calgary Opera.
On pourrait
définir Manon Feubel par son talent, sa voix reconnaissable entre toutes, sa
musicalité ou encore sa nature perfectionniste. De la Scala de Milan en Italie,
en passant par le Théâtre des Champs Elysées et la Salle Pleyel de Paris, le
Konzerthaus de Vienne, l’Alice Thully Hall au Lincoln Center de New-York, dans
les Festivals d’Orange en France et de Santander en Espagne pour ne citer que
quelque uns de ces prestigieux théâtres et salles où Manon a eu l’opportunité
de se présenter mais également dans les pays tels Israël, Allemagne, Monaco, Grèce,
Suisse, Angleterre et le Canada d’où elle est originaire entre ses passages aux
Opéras de Montréal et Québec.
Reconnue
pour son travail dans le répertoire baroque, la soprano canadienne Karina
Gauvin chante également avec succès Mahler, Bach, Beethoven, Britten et la
musique de la fin du XXe et du XXIe siècle. Parmi les prestigieuses
distinctions qu'elle a reçues, citons le titre de "Soliste de
l'année" décerné par la Société internationale de radiodiffusion, le
premier prix du concours de la radio de la CBC, le prix Virginia Parker et le
prix commémoratif Maggie Teyte Londres.
Que
Marie-Nicole Lemieux brille aujourd’hui au firmament du chant mondial n’a rien
de surprenant : la chanteuse, comme la femme, rayonnent de cette aura qui
n’appartient qu’aux plus grandes ! Ses qualités vocales éclatent lorsqu’elle
remporte en 2000 le Prix de la Reine Fabiola et le Prix du Lied au Concours
Reine Elisabeth de Belgique. Elle entame alors une carrière internationale qui
la mène sur les plus grandes scènes du monde : le Canadian Opera Company de
Toronto, l’Opéra de Montréal, la Scala de Milan, le Royal Opera House Covent
Garden, le Wigmore Hall de Londres, La Monnaie de Bruxelles, les Staatsoper de
Berlin, Munich et Vienne, l’Opernhaus de Zurich, le Theater an der Wien, le
Teatro Real de Madrid, le Liceu de Barcelone, les Festivals de Salzbourg et de
Glyndebourne, l’Opéra national de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées, les
Chorégies d’Orange.
Les voix
d’hier
Décédée
l’an dernier, Huguette Tourangeau entra en 1958 au Conservatoure où elle étudia
le chant avec Ruzena Herlinger, le répertoire avec Otto-Werner Mueller et la
déclamation avec Roy Royal. En 1964, elle débuta dans le rôle de Mercédès dans Carmen,
sous la direction de Zubin Mehta qui l'incita à participer aux auditions
régionales du Metropolitan Opera. Elle se classa l'une des cinq finalistes sur
5000 candidats, obtenant un prix de 2000 $ de la Fisher Foundation et un
contrat avec la compagnie de tournée du Metropolitan avec qui elle apparait
dans le rôle titre de Carmen dans 56 villes nord-américaines avant de reprendre
ce rôle au New York City Opera. Elle allait par la suite chanter et enregistrer
de nombreux rôles aux côtés de Joan Sutherland et son mari, le chef Richard
Bonynge.
En 1945,
Pierrette Alarie remporte les Auditions of the Air du Metropolitan Opera, où
elle fait ses débuts le 8 décembre 1945. Comme soliste, et aussi avec Léopold
Sinoneau, son mari, elle chante sur les plus grandes scènes d'Europe et
d'Amérique du Nord, et les critiques font l'éloge de sa voix cristalline et de
sa maîtrise de la musique d'opérette et de l'opéra lyrique. Alarie et Simoneau
reçoivent le Prix De Musique Calixa-Lavallée en 1959 et le Diplôme d'honneur de
la Conférence canadienne des arts (1983). Leur album Airs de concert et duos de
Mozart remporte le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros à Paris en
1961.
Né à
Montréal, George London se fixa en Californie avec ses parents à l'âge de 15
ans. Il se produisit comme amateur et professionnel, puis il partit à l'étranger
en 1947 afin d'étudier avec Enrico Rosati. Il revint en 1947-48 pour une
tournée au Canada et aux États-Unis avec le Columbia Bel Canto Trio, aux côtés
de Frances Yeend et de Mario Lanza. Il fit ses débuts européens à l'Opéra
d'État de Vienne dans le rôle d'Amonasro d' Aïda (3 septembre 1949). Son succès
fut immédiat et lui valut bientôt les engagements des plus importants centres
musicaux dont Édimbourg (1950), Bayreuth (1951), Salzbourg (1952) et La Scala
de Milan (1952). Le 23 septembre 1960, il fut le premier Nord-Américain à
chanter le rôle titre de Boris Godounov à l'Opéra du Bolchoï à Moscou.
Pour clore
le montage (et comme présage d’un partage intégral plus tard cette année), j’ai
chouisu le cinquième et dernier acte de la version originale de Don Carlos
de Verdi. Don Carlos est un « grand opéra à la française » en cinq actes sur un
livret de Joseph Méry et Camille du Locle, d'après la tragédie Don Carlos de
Friedrich von Schiller, créé le 11 mars 1867 à l'Opéra de Paris.
Remanié en
1884, il devient Don Carlo pour la scène italienne. C'est dans la
traduction italienne qu'il conquiert les scènes mondiales, donnant lieu au
mythe d'une version italienne, alors que les deux versions (1866-67 et 1884)
furent composées sur un texte français.
La discographie
de la version originale est passablement limitée, mais compte une version
radiophonique de 1973 pour la BBC qui contient une distribution bondée des
chanteurs québécois : Robert Savoie (absent car sib personnage est tué
lors de l’acte précédent), André Turp, Joseph Rouleau et Edith Tremblay
chantent les rôles principaux.
Bonne
écoute!


:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-7281800-1437932722-8775.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9119674-1475110773-7894.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5483105-1399406957-1295.jpeg.jpg)


:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-3544550-1335534495.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-12534446-1537135884-5743.jpeg.jpg)



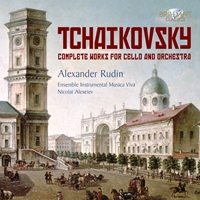
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10036168-1490510152-8406.jpeg.jpg)
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-7208102-1436231873-8020.jpeg.jpg)








