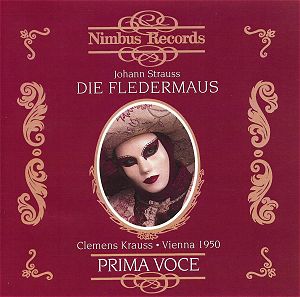|
| Le billet suivant est mon Mardi en Musique du 14 janvier 2014. |
Lors de ma réflexion de la semaine dernière, j'ai proposéla d'écouter la quatrième suite de Tcaïkovski. Ma playlist d'aujourd'hui propose de compléter la séquence avec l'écoute des trois autres suites numérotées du compositeur.
Composées entre 1878 et 1887 et insérées dans le catalogue chronologique du compositeur entre la production de symphonies, ces suites suivent le modèle traditionnel du rassemblement de mouvements de danse, augmenté par des muvements plus élaborés, organisés das une forme sans doute moins rigide que celui de la symphonue, d'où j'ose croire leur attrait pour le comositeur Russe.
A propos de sa première suite, il écrura à l'automne de 1878:
Il est intéressant de noter que durant la période de 10 ans enre la composition de sa quatriàme et cinquième symphonies, Tchaikovsky tenta de composer une symphonie qui deviendra sa troisième suite... Restant fidèle au thème du mois, la troisième suite comporte une élégante démonstration de variations pour orchestre!
Plus de détails sur la composition de ces oeuvres dans la page wiki du site Tchaikovsky Research
A propos de sa première suite, il écrura à l'automne de 1878:
(...) j'ai mis sur papier le croquis d'un scherzo pour orchestre. C'est seulement par la suite que l'idée m'est venue de composer tout un cycle de pièces pour orchestre, qui forment une Suite dans le style de (Franz) Lachner.Cette formule musicale date des ouvertures pour orchestre de Jean-Sébastien Bach et Georg Phillip Telemann, et reste en vogue depuis. Parmi les compositeurs contemporains du Russe (en plus de Lachner), on note un de ses riveaux de Saint-Pétersbourg, le compositeur et critique César Cui qui en composera pou le piano et en orchestrera lui-même (ou orchestrées opar Glazounov).
Il est intéressant de noter que durant la période de 10 ans enre la composition de sa quatriàme et cinquième symphonies, Tchaikovsky tenta de composer une symphonie qui deviendra sa troisième suite... Restant fidèle au thème du mois, la troisième suite comporte une élégante démonstration de variations pour orchestre!
Plus de détails sur la composition de ces oeuvres dans la page wiki du site Tchaikovsky Research
Bonne écoute!
DETAILS
Pyotr Ilich TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Suite No. 1 en ré mineur, Op. 43 (TH 31)
Orchestre Symphonique de Radio-Moscou sous Arvīds Jansons
Suite No. 2 en ut majeur, Op. 53 (TH 32), "Suite charctéristique"
Winterthur Symphony Orchestra sous Walter Goehr
Suite No. 3 en sol majeur, Op. 55 (TH 33)
Orchestre Symphonique de la Radio-Télévision Coréenne sous Mikhail Pletnev